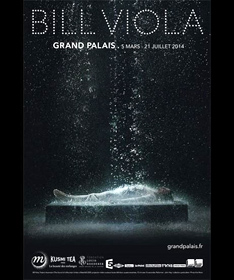 Lui, ce n’est pas du cinéma : c’est de la sculpture, de la texture, de l’entomologie, de nouvelles horloges. Nulle volonté chez lui de se présenter comme un réalisateur. Son travail, l’artiste américain Bill Viola, pionnier de l’art vidéo né en 1951, l’envisage comme une « capture d’âmes », une « sculpture du temps », une rééducation du regard sans contraintes de narration ou de personnages. Là se trouve une différence importante entre l’art vidéo et le cinéma, où le premier s’affranchit des (ultimes !) contraintes structurelles du second pour livrer au regard plus qu’un écran, plus qu’une surface de projection. Des écrans, Bill Viola en tapisse les murs, en fixe par séries de cinq, en remplit toute une pièce, sur différentes matières et différents formats, se faisant couturier minimaliste de la toile blanche. Et de l’image assemblée à cette installation naît un objet, avec son dehors et son dedans, comme une fenêtre ouverte sur un espace mental où se répète en boucle, sans nous mais par accident pour nous, un unique et étrange fragment d’une intériorité palpable comme une étoffe.
Lui, ce n’est pas du cinéma : c’est de la sculpture, de la texture, de l’entomologie, de nouvelles horloges. Nulle volonté chez lui de se présenter comme un réalisateur. Son travail, l’artiste américain Bill Viola, pionnier de l’art vidéo né en 1951, l’envisage comme une « capture d’âmes », une « sculpture du temps », une rééducation du regard sans contraintes de narration ou de personnages. Là se trouve une différence importante entre l’art vidéo et le cinéma, où le premier s’affranchit des (ultimes !) contraintes structurelles du second pour livrer au regard plus qu’un écran, plus qu’une surface de projection. Des écrans, Bill Viola en tapisse les murs, en fixe par séries de cinq, en remplit toute une pièce, sur différentes matières et différents formats, se faisant couturier minimaliste de la toile blanche. Et de l’image assemblée à cette installation naît un objet, avec son dehors et son dedans, comme une fenêtre ouverte sur un espace mental où se répète en boucle, sans nous mais par accident pour nous, un unique et étrange fragment d’une intériorité palpable comme une étoffe.
Un plongeur de chair pâle suspendu au-dessus d’une eau verte et mouvante. Une vieille femme grenue, maigre et blanche qui s’allonge sur une dure paillasse de moine, puis s’allonge à nouveau, et encore, sans pourtant jamais se relever. Un mur de feu qui devient graduellement noir, graduellement liquide, pour accueillir la silhouette en robe qui s’y noie.
 Et pourtant. Les images qui défilent et se répètent portent la graine de ce qui fait le cinéma : des propositions d’agencement, de mouvements et de sons qui deviennent unités et prennent le sens que chacun leur accorde, avec le réflexe éventuel de chercher une forme de récit, d’action, de héros et de dénouement. « C’est l’histoire d’une femme qui marche dans le désert, ses longues robes rouges et ses cheveux noirs volent dans le vent, le ciel brûle, l’horizon tremble de chaleur, et à la fin d’un long parcours elle rencontre une autre femme. » Mais la brièveté du film, l’absence de contexte, la lenteur même des mouvements chez les acteurs de Bill Viola force à se détacher de cette conclusion pour laisser l’esprit voguer sur les formes et intégrer comme uniques les milliards de minuscules interactions entre les choses ou personnes filmées.
Et pourtant. Les images qui défilent et se répètent portent la graine de ce qui fait le cinéma : des propositions d’agencement, de mouvements et de sons qui deviennent unités et prennent le sens que chacun leur accorde, avec le réflexe éventuel de chercher une forme de récit, d’action, de héros et de dénouement. « C’est l’histoire d’une femme qui marche dans le désert, ses longues robes rouges et ses cheveux noirs volent dans le vent, le ciel brûle, l’horizon tremble de chaleur, et à la fin d’un long parcours elle rencontre une autre femme. » Mais la brièveté du film, l’absence de contexte, la lenteur même des mouvements chez les acteurs de Bill Viola force à se détacher de cette conclusion pour laisser l’esprit voguer sur les formes et intégrer comme uniques les milliards de minuscules interactions entre les choses ou personnes filmées.
« Les images fixes peuvent contenir des petites histoires », explique David Lynch lorsqu’il se fait photographe. Plus riches et moins nettes, les images mouvantes, si elles forment un ensemble uni comme la déclinaison d’une image fixe, contiennent à la fois des fresques, des graines d’histoires, des germes de sens, et des exercices de style pour réalisateurs.
Ainsi les matières, les structures et les interactions détaillées par Bill Viola pourraient nourrir le cinéma, c’est-à-dire à la fois la recherche du créateur et la compréhension de l’œil qui regarde. Et la richesse étonnante de sa palette, qui décline des références esthétiques, religieuses et culturelles de toutes les époques, serait capable d’inspirer ou d’expliquer un grand nombre de genres et de formes. Du vaudeville au drame, du noir et blanc au Technicolor, de la nature morte à la 3D, Bill Viola ne propose pas des films, mais peut-être bien des instants de cinéma qu’il dissèque par le ralenti.
Propositions libres, incomplètes et tout à fait contestables…
1 – Bill Viola, l’hommage à George Méliès : Escamotage d’un plongeur (The Reflecting Pool, 1977-1979)
Un bassin d’extérieur de forme carrée, une eau mouvante verte et noire qui reflète les arbres de l’arrière-plan. Un homme apparaît et s’apprête à plonger : l’image se fige, laissant une masse de chair suspendue au-dessus de l’eau, tandis que le liquide continue de remuer. Escamotage à la Georges Méliès, l’admirateur de Houdin et le père du cinéma, qui ne se lassait pas d’étendre le domaine de la prestidigitation par des coupures opportunes de la bande, parvenant ainsi à faire apparaître des femmes dans des salons vides et à changer en un clin d’œil des voitures en corbillard. Par le même type de technique, Bill Viola « sculpte le temps », permettant à des images séparées dans le réel de se rencontrer sur l’écran. Peu à peu le plongeur figé s’estompe contre le vert. Deux silhouettes apparaissent en reflet dans l’eau, se rapprochent et se croisent le long de la margelle, sans que jamais l’on voit quiconque marcher près du bassin. Puis l’eau s’assombrit et le plongeur en sort, nu comme un ver, et s’en va.
 2 – Bill Viola et David Lynch (The Sleep of Reason, 1988)
2 – Bill Viola et David Lynch (The Sleep of Reason, 1988)
Lynch, pratiquant régulier de la méditation transcendantale, qu’il utilise comme un moyen de plonger vers la source où attraper les « gros poissons » de la création. Viola, qui conçoit ses films comme des méditations : la lenteur, la répétition, le symbolisme de l’inconscient, oui, nous y sommes ! L’installation The Sleep of Reason montre une veille commode au centre d’une pièce vide sur laquelle sont posés un vieux vase de porcelaine, un vieux radio-réveil, un vieux téléviseur en noir et blanc où apparaît le visage d’une vieille personne endormie. Rien ne se passe, les minutes changent en rouge sur le réveil, jusqu’à ce que brutalement la pièce s’éteigne et que s’élève un fort bruit d’usine ou de train en marche. Les quatre murs se couvrent d’images tremblantes d’orages, ou de squelettes aux rayons X, ou d’insectes ou de visages en gros plan. Quelques secondes, puis le rêve disparaît, le sommeil redevient lisse et paisible. A peine averti de cette manière, le spectateur assis dans un coin se laisse ensuite surprendre et agresser par le rêve suivant. Mais bientôt il l’attend. S’installe alors une sorte de bercement, de rythme aller-retour entre le dehors et le dedans, où l’on craint et souhaite les plongées dans le hasard dérangeant de l’intérieur qui sont habituelles au cinéma de David Lynch.
 3 – Bill Viola et Stanley Kubrick : 2001, Odyssée de l’Espace (Heaven and Earth, 1992)
3 – Bill Viola et Stanley Kubrick : 2001, Odyssée de l’Espace (Heaven and Earth, 1992)
2001 : de la naissance de l’homme à son déclin puis à sa renaissance dans un espace et un temps trop larges pour être clairement définis. Par une sculpture vidéo Bill Viola recrée ce cycle, disposant deux colonnes – l’une montant du sol et l’autre tombant du plafond – chacune munie en son bout d’un écran, les deux se faisant face comme les terminaisons d’une synapse. Celui du bas montre l’image fixe en noir et blanc d’un nouveau-né posé dans son berceau, et celui du haut celle d’un vieillard allongé dans un lit. Les images, silencieuses et sans contexte, se réfléchissent l’une l’autre, les traits se confondent, le début et la fin se mêlent. Elles forment un tout à elles deux ; un peu, si l’on veut, comme le retour du fœtus de Kubrick vers une certaine Terre indéfinie en provenance de la demeure extraterrestre du vieillard.
4 – Bill Viola et James Cameron : il y a 3D et 3D (The Veiling, 1995)
Une pièce très sombre aux parois noires. Douze écrans de toile argentée suspendus au plafond en parallèle l’un de l’autre. De chaque côté de la salle, un projecteur encastré dans le mur. Les deux appareils diffusent les mêmes images, de vagues et d’écume, de cheveux dans le vent, d’œil et de battements de cils, d’un arbre la nuit éclairé par une seule lampe. Les images se posent sur les six premiers écrans, agrandies à chaque fois par diffraction, jusqu’à se réduire sur les six autres pour revenir à l’autre projecteur. Créé par cette répétition, un animal marin semble flotter au milieu de la pièce, se mouvant lentement dans les faisceaux des projecteurs ; la 3D devient bien réelle, assez vraie pour que l’on tende la main pour sentir le lent ballet de la créature.
5 – Bill Viola et James Cameron, bis : sous l’océan (Ascension, 2000)
 1950′s : Bill Viola, encore enfant, tombe au fond d’un lac et y découvre « le plus bel univers qu’il ait jamais vu ». Il en conclut qu’il faut chercher les belles choses « sous la surface » et conçoit plus tard ces vidéos comme un moyen de replonger dans l’onde. Pour cela l’eau est très présente dans l’œuvre de Bill Viola, tour à tour vive et effervescente, calme et cristalline, pâle ou d’un bleu profond, ou riche et torrentielle et blanche comme la neige, capable d’apaiser en caressant ou en engloutissant. En elle, Viola voit une image de la continuité du temps, de même que la vidéo est flux d’images ininterrompues : mais de ce travail de texture, James Cameron pourrait tirer une réflexion sur de nouveaux arrangements lumineux prêts à servir un nouvel Abyss.
1950′s : Bill Viola, encore enfant, tombe au fond d’un lac et y découvre « le plus bel univers qu’il ait jamais vu ». Il en conclut qu’il faut chercher les belles choses « sous la surface » et conçoit plus tard ces vidéos comme un moyen de replonger dans l’onde. Pour cela l’eau est très présente dans l’œuvre de Bill Viola, tour à tour vive et effervescente, calme et cristalline, pâle ou d’un bleu profond, ou riche et torrentielle et blanche comme la neige, capable d’apaiser en caressant ou en engloutissant. En elle, Viola voit une image de la continuité du temps, de même que la vidéo est flux d’images ininterrompues : mais de ce travail de texture, James Cameron pourrait tirer une réflexion sur de nouveaux arrangements lumineux prêts à servir un nouvel Abyss.
6 – Bill Viola et… Shakespeare : Macbeth (Three Women, 2008)
Trois femmes en noir et blanc se tiennent debout, immobiles et serrées l’une contre l’autre au centre d’un écran tout en hauteur fixé sur un mur noir. Leurs visages, leurs longs cheveux et leurs robes foncées attrapent une lumière blafarde et semblent coulées l’une dans l’autre par la nuée de parasites qui couvre l’image. Sans quitter le spectateur des yeux, elles avancent lentement, comme en apesanteur, légèrement inquiétantes dans la vacuité de leur visage. Trois femmes menaçantes, un air de connivence maléfique entre elles et contre moi : les sorcières de Macbeth s’avancent, suggérant à quel point il serait merveilleux et approprié de voir toute la tragédie jouée derrière un rideau triste et flou de parasites. La première touche l’écran, un rideau gris s’ouvre pour la laisser passer : le rideau coule comme de l’eau sur elle, la lavant et lui rendant sa couleur, des cheveux blonds et une robe bleue. Elle s’observe ainsi. Mais elle revient bientôt en arrière pour disparaître à nouveau dans le gris où sont restées ses sœurs.
7 – Bill Viola et… tous : acteurs, émotions et personnages (The Quintet of the Astonished, 2000)
Cinq personnages, une femme et quatre hommes, debout et rapprochés devant un fond noir, filmés en un plan montrant seulement le haut du corps. Lumière blanche et coupante, couleurs ocres et teints cireux qui rappellent la peinture médiévale, Viola revendiquant un tableau de Jérôme Bosch comme inspiration de cette vidéo. Que se passe-t-il ? Pas grand-chose, je m’ennuie ; saisis au ralenti, les personnages sourient, pleurent, se rapprochent et s’éloignent l’un de l’autre, chacun pris dans une gamme individuelle d’expressions et d’émotions qui forme un tout extrêmement lent et riche en détails. Et voici que peu à peu je comprends : les grimaces, les inclinaisons du visage, les demi-sourires et les esquisses de froncement prennent une signification émotionnelle vaste mais claire sous mes yeux, et le groupe finit par former un tout sans même se regarder. Le ballet lent devient hypnotisant et chargé de sens. Qui sont-ils, d’où viennent-ils, que font-ils? Les questions essentielles que Bill Viola ne cesse de se poser, qu’il définit comme le fil conducteur de son œuvre, s’imposent sur ces personnages.
… Ainsi, et d’autres encore. Dans cette lenteur et cette variété le regard s’exerce, apprend la patience et la précision, s’enrichit de techniques et de compréhensions nouvelles qui aident à mieux regarder ce cinéma où la réalisation raconte les histoires.
Bill Viola, exposition au Grand Palais jusqu’au 21 juillet 2014.
