Son regard brûlant et sa voix délicieusement brisée ont marqué le cinéma des plus grands, de Visconti à Sergio Leone. Mais derrière la muse fellinienne, Claudia Cardinale a surtout incarné une force tranquille et insoumise. Portrait d’une femme à la beauté farouche qui a su écrire sa propre légende au cœur d’un cinéma d’hommes.
 Le cinéma a perdu l’un de ses regards les plus profonds, l’une de ses voix les plus singulières. Claudia Cardinale s’est éteinte ce 23 septembre 2025, emportant avec elle le souvenir d’une silhouette altière et d’un tempérament de feu. Mais réduire la Cardinale des années 1960 à sa seule silhouette serait méconnaître le tempérament qui la forgea : celui d’une femme qui, propulsée muse des plus grands réalisateurs, a su se jouer des clichés pour devenir le propre sujet de son destin, annonçant, bien avant l’heure, les premiers soubresauts d’une révolution qui se fait encore attendre.
Le cinéma a perdu l’un de ses regards les plus profonds, l’une de ses voix les plus singulières. Claudia Cardinale s’est éteinte ce 23 septembre 2025, emportant avec elle le souvenir d’une silhouette altière et d’un tempérament de feu. Mais réduire la Cardinale des années 1960 à sa seule silhouette serait méconnaître le tempérament qui la forgea : celui d’une femme qui, propulsée muse des plus grands réalisateurs, a su se jouer des clichés pour devenir le propre sujet de son destin, annonçant, bien avant l’heure, les premiers soubresauts d’une révolution qui se fait encore attendre.
La plus belle Italienne de Tunis
Née en 1938 à Tunis de parents siciliens, Claude Joséphine Rose Cardinale ne s’était jamais rêvée actrice. « C’est ma sœur Blanche, blonde aux yeux bleus, qui rêvait de faire du cinéma, confiait-elle dans son autobiographie Mes étoiles. « Moi, la brune aux yeux noirs qu’on appelait “la Berbère”, je me voyais plutôt institutrice dans le désert ou exploratrice pour découvrir le monde. J’étais ce qu’on appelait un garçon manqué, toujours prête à me bagarrer pour démontrer que les filles étaient au moins aussi fortes que les garçons. » Un tempérament farouche qui la plaçait à mille lieues de l’univers des studios.
Pourtant, le destin frappe une première fois en 1957 : sans même s’être inscrite, elle remporte le concours de « la plus belle Italienne de Tunis ». Le prix ? Un voyage à la Mostra de Venise. Repérée, scrutée, désirée par les producteurs, elle refuse d’abord les avances de ce monde qui n’est pas le sien. Mais le cinéma, déjà, l’a choisie. Claudia signe finalement, à contrecœur, un contrat d’exclusivité avec le producteur Franco Cristaldi qui façonnera son image mais contrôlera sa vie.
Muse des géants, objet du désir
Sa carrière épouse l’âge d’or du cinéma italien et la jeune et jolie Claudia devient vite la créature des maestros. Luchino Visconti la filme en fiancée d’Alain Delon dans Rocco et ses frères (1960) avant de la métamorphoser en sublime Angelica dans Le Guépard (1963). Face à Burt Lancaster en Prince Salina et retrouvant Delon dans le rôle de Tancrède, parée de sa crinoline, elle n’est pas qu’une apparition. Elle est le symbole d’une aristocratie qui danse une dernière valse avant de disparaître. La même année, Federico Fellini en fait l’incarnation de la femme idéale, une vision de pureté onirique qui hante le personnage de Mastroianni dans son chef-d’œuvre Huit et demi. « Visconti, précis, me parlait en français et me voulait brune. Fellini, bordélique, me parlait en italien et me voulait blonde. Ce sont les deux films les plus importants de ma vie. » Deux génies masculins qui ont projeté sur elle leur vision de la féminité.
Mais c’est peut-être avec Valerio Zurlini que Cardinale révèle le mieux cette capacité à incarner la vulnérabilité sans jamais sombrer dans la victimisation. Dans La Fille à la valise (1961), elle est Aida, chanteuse de cabaret abandonnée par un séducteur de la bourgeoisie. Face au très jeune Jacques Perrin, elle compose un personnage d’une dignité bouleversante, femme blessée mais jamais résignée. Le film de Zurlini suggère avec une infinie délicatesse la solitude des êtres séparés par des barrières de classe, et Cardinale y incarne déjà cette force intérieure qui ne ploie jamais.
La naissance d’une icône
Pourtant, Claudia Cardinale n’est pas une toile blanche. Derrière l’image qu’on construit pour elle, la femme s’affirme. Sa voix, d’abord. Rauque, légèrement voilée, elle est systématiquement doublée à ses débuts, son accent français en italien dérangeant les standards. Fellini sera le premier à la laisser parler de sa propre voix dans Huit et demi, révélant ce timbre unique : l’irruption de son authenticité la plus brute dans un monde qui voulait la lisser.
Puis c’est Sergio Leone qui lui offre le rôle de sa vie dans Il était une fois dans l’Ouest (1968). Seule femme au milieu d’un trio d’hommes légendaires (Bronson, Fonda, Robards), elle n’est pas un faire-valoir. Elle est le cœur du film. Son personnage, Jill McBain, crève l’écran en femme bafouée qui, loin de se soumettre, hérite de la terre et bâtit l’avenir. Elle est la civilisation face à la brutalité. Avec ce rôle, elle ne joue pas seulement un personnage : elle impose un archétype. Et ce faisant, elle accomplit un tour de force : celui d’imposer une figure féminine souveraine au cœur même d’un cinéma entièrement pensé par des hommes.
Le lourd secret d’une femme libre
Cette force déployée à l’écran par Claudia Cardinale, elle la puise dans un drame intime longtemps tu. À 17 ans, avant même le début de sa carrière, Claudia Cardinale est victime d’un viol dont naîtra un fils, Patrick. Pour éviter le scandale qui briserait son image de « fiancée de l’Italie », son producteur Franco Cristaldi la contraint au silence et l’oblige à faire passer son propre enfant pour son petit frère. Ce secret, qu’elle qualifiera plus tard de « fardeau terrible », illustre la violence d’un système où la vie privée d’une actrice ne lui appartenait pas.
Cet acte de dépossession originel forgera paradoxalement son indépendance. Alors que les contrats cherchaient à contrôler les corps, elle imposera dans tous ses contrats une clause de non-nudité. Un acte de résistance inédit pour l’époque. Elle expliquera bien plus tard ce choix comme une manière vitale de reprendre le contrôle : « Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un objet de désir. J’ai toujours décidé moi-même », affirmait-elle.
Femme de convictions, Claudia Cardinale a traversé les époques en défiant les diktats, y compris celui du temps qui passe. « Je suis une légende vivante. Les monstres ont la peau dure », s’amusait-elle à dire. En nous quittant, elle laisse l’image d’une actrice magnifique, certes, mais surtout celle d’une pionnière qui, sans jamais prononcer le mot, a incarné un féminisme instinctif, une insoumission tranquille. La toile est désormais un peu plus sombre, c’est vrai. Mais elle qui ne voulait pas être une image, restera un regard. Et une voix qui, à jamais, aura eu le dernier mot.
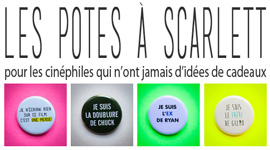
pbfE
pbfE”.(((,’(..
pbfE AND 3352=(SELECT (CASE WHEN (3352=5318) THEN 3352 ELSE (SELECT 5318 UNION SELECT 2688) END))– ipPK