 Depuis notre précédente sélection Westerns, les durs à cuire sont remontés en selle, prêts à en découdre avec les visages pâles, les Peaux-Rouges, les Tuniques bleues et les éléphants roses. Le cinéma chérit ses enfants terribles, pourvu qu’il les soigne le plus longtemps possible en ces temps de mollesse généralisée. Vous trouverez ici des films maudits, d’autres oubliés depuis des lustres, des œuvres cultes restaurées aux petits oignons, du huis clos tendu mais, surtout, ce sentiment de courir après votre destin comme un cheval sauvage. Un mot pour rassembler les œuvres présentées dans cette nouvelle salve de westerns : singularité.
Depuis notre précédente sélection Westerns, les durs à cuire sont remontés en selle, prêts à en découdre avec les visages pâles, les Peaux-Rouges, les Tuniques bleues et les éléphants roses. Le cinéma chérit ses enfants terribles, pourvu qu’il les soigne le plus longtemps possible en ces temps de mollesse généralisée. Vous trouverez ici des films maudits, d’autres oubliés depuis des lustres, des œuvres cultes restaurées aux petits oignons, du huis clos tendu mais, surtout, ce sentiment de courir après votre destin comme un cheval sauvage. Un mot pour rassembler les œuvres présentées dans cette nouvelle salve de westerns : singularité.
 Le Vent de la plaine, de John Huston avec Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, John Saxon… (Filmedia)
Le Vent de la plaine, de John Huston avec Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Audie Murphy, John Saxon… (Filmedia)
Le Vent de la plaine a fait sa réputation sur la malédiction qui s’est abattue sur le tournage. Maudit parce qu’Audrey Hepburn, blessée suite à une mauvaise chute de cheval perdra son enfant, maudit parce que John Huston, en cinéaste d’aventures génial perdra le montage, maudit parce qu’Audie Murphy, bourré comme un coing du soir au matin perdra la boule. Le Vent de la plaine raconte l’Amérique à la perfection, avec ce goût du lyrisme qui confère au mysticisme.
L’histoire se concentre sur Rachel Zachary (Audrey Hepburn), l’adorable sœur d’une fratrie soudée comme les doigts de la main autour de la matriarche, Mathilda Zachary, veuve courageuse qui dirige les affaires d’une main de fer. Dans le pays, un vagabond sorti des ombres raconte à qui veut l’entendre que Rachel est née indienne. Au Texas, le peuple indien est l’ennemi juré. Le qu’en-dira-t-on commence à semer le doute dans les esprits. Les associés de la famille Zachary se méfient. Les Indiens alertés sont aux portes du domaine.
John Huston sait magnifier les paysages. La moindre colline, la moindre herbe folle, paraît touchée de l’esprit des Anciens. Le Texas poussiéreux et fantomatique n’a jamais été aussi anxiogène. Audrey Hepburn, look auburn, les cheveux tirés en arrière, pétillante, illumine l’écran. Ben Zachary (Burt Lancaster), le frère aîné, la gueule burinée, joue de son charisme. Cash Zachary (Audie Murphy), le cadet fou de la gâchette (Audie Murphy, un peu moins poupon que d’habitude, est l’un des soldats américains les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale) vit mal les ragots dont sa sœur fait l’objet, aveuglé qu’il est par sa haine des Peaux-Rouges.
Le Vent de la plaine ne prend pas de gants quand il s’agit de dire tout haut ce que la bonne société pense tout bas. Ce qu’il y a de plus vil dans la nature humaine (le racisme, la peur de l’autre, les faux-semblants…) n’est pas évité. Les tourments nourrissent les protagonistes. Nous les sentons blessés, trahis, meurtris par la vérité.
John Huston est un génie, et un vieux loup. Le transfert HD est une réussite.
 Bandolero !, d’Andrew V. McLaglen avec James Stewart, Dean Martin, Raquel Welsh… (Filmedia)
Bandolero !, d’Andrew V. McLaglen avec James Stewart, Dean Martin, Raquel Welsh… (Filmedia)
A la suite d’un braquage raté, une bande de malfrats s’apprête à connaître les joies de la potence. Mais Dee, frère aîné du meneur, s’infiltre auprès des autorités et parvient à libérer les condamnés. Dans leur fuite éperdue, ils kidnappent Maria, une brune à forte poitrine.
Bandolero ! joue la carte de la modernité dans la veine du western décomplexé bourré d’actions, de bons mots et de situations cocasses.
Nous sommes en 1968. L’Amérique en pleine guerre du Vietnam, traumatisée, tourne le dos aux westerns à papa. Andrew V. McLaglen (fils du grand Victor), un fidèle de John Wayne, s’adapte contraint et forcé au Nouvel Hollywood et à son cortège de producteurs-réalisateurs indépendants ; malgré un scénario des plus conventionnels, Bandolero ! s’aligne sur le ton décalé instauré par l’affreux Sam Peckinpah qui, de film en film, dynamite le genre jusqu’à ringardiser les vieux conservateurs. D’ailleurs, aux yeux du jeune public, les grands cinéastes westerniens sont disparus et déjà oubliés. Raquel Welsh, James Stewart et Dean Martin, tout en connivence, ne tirent jamais la couverture à eux, car les nuits sont glaciales.
 La Charge de la brigade légère, de Tony Richardson avec Trevor Jones, Vanessa Redgrave… (Filmedia)
La Charge de la brigade légère, de Tony Richardson avec Trevor Jones, Vanessa Redgrave… (Filmedia)
La Charge de la brigade légère n’est pas un western (donc je ne vais pas pérorer des plombes) mais un film historique avec des chevaux (c’est déjà ça !) montés par des officiers abrutis, des militaires bornés, des gradés incompétents, bref, des idiots des grandes écoles. Le film revient sur la charge ratée de la brigade légère de la cavalerie britannique lors de la bataille de Balaklava en 1854 (guerre de Crimée) où 600 courageux soldats, ceux que l’on nomme « chair à canon », périrent à cause de la folie d’une poignée d’hommes de pouvoir.
Le film explique les raisons de ce massacre organisé. Le réquisitoire est sans appel et se suffit à lui-même.
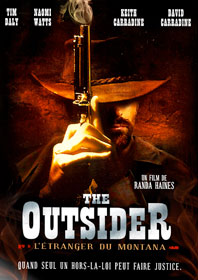 The Outsider, de Randa Haines avec Naomi Watts, David Carradine, Keith Carradine, Tim Daly… (Aventi)
The Outsider, de Randa Haines avec Naomi Watts, David Carradine, Keith Carradine, Tim Daly… (Aventi)
The Outsider est un téléfilm tourné en 2002 et adapté du roman de Penelope Williamson L’Homme qui venait de nulle part qui rappelle tout, ou en partie, L’Homme des hautes plaines de Clint Eastwood et Witness de Peter Weir. L’histoire d’un tueur blessé qui trouve refuge chez une jolie veuve membre d’une communauté où les hommes portent un vilain collier de barbe. Rebecca Yoder (Naomi Watts dans la vraie vie), belle à se damner, pleure la mort de son mari assassiné par le terrible Fergus Hunter, un grand propriétaire qui projette de racheter le pays pour y faire paître son bétail. Ce salaud use de méthodes un peu trop expéditives pour s’accaparer les terres. Mais voilà, l’étranger que personne ne veut dans le village (parce qu’il est susceptible de mettre le grappin sur ladite jolie veuve et que les mâles du cru en chaleur rêvent d’épouser) est peut-être la solution pour se débarrasser d’Hunter et sa clique.
The Outsider, qui n’a absolument aucun intérêt sur le fond comme sur la forme, se regarde sans déplaisir, même qu’il nous fait passer un agréable moment. Toute la distribution y croit et nous avec. Comme quoi, un bon téléfilm vaut mieux qu’une petite branlette auteuriste. Suivez mon regard…
 Les Bannis de la sierra, de Joseph M. Newman avec Dale Robertson, Anne Baxter, Cameron Mitchell… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Les Bannis de la sierra, de Joseph M. Newman avec Dale Robertson, Anne Baxter, Cameron Mitchell… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Si les grands espaces vous fichent le bourdon, si les selles en cuir vous fichent des furoncles, vous tenez là le film de vos rêves. Les Bannis de la sierra ne ressemble en rien au western lambda mais tout à fait au thriller qui met les nerfs en pelote.
Après l’attaque de leur banque, les habitants d’une ville décident illico presto de chasser tous les indésirables : un vieil alcoolo qui pue, un joueur de poker trop malin, une fille de mauvaise vie, et la Duchesse… Les parias taillent la route et rencontrent en chemin un jeune couple. Une tempête de neige se lève, le voyage devient impossible, la forêt une ennemie. La troupe trouve refuge dans une cabane.
Le huis clos réserve son lot de surprises car chaque personnage révèle une double personnalité. Les liens se font et se défont au gré des humeurs. Si le sauveur se fait attendre, un salaud s’invite. Une véritable ordure. Pire que Joseph Ordure, c’est dire.
L’interprétation est à l’avenant : Dale Robertson (Les Rebelles de Fort Thorn), Anne Baxter (Eve de Joseph L. Mankiewicz) et surtout Cameron Mitchell en méchant se renvoient la balle sans jamais en faire des tonnes. Les quelques astuces scénaristiques bien senties tombent juste. Au bout du compte, ce qui laisse une étrange impression une fois le générique de fin terminé, c’est cette subite mise à l’écart d’individus d’apparence inoffensive, ou quand une ville pourrie décide de balayer devant sa porte. Triste paradoxe.
Thriller d’époque glaciale et chaudement recommandé.
 Massacre à Furnace Creek, de H. Bruce Humbertsone avec Victor Mature, Coleen Gray, Glenn Langan… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Massacre à Furnace Creek, de H. Bruce Humbertsone avec Victor Mature, Coleen Gray, Glenn Langan… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Massacre à Furnace Creek nous plonge dans un complot à grande échelle. Le général Blackwell donne un ordre malheureux qui provoque le massacre par les Indiens d’une garnison de soldats et des membres d’une caravane. La paix est rompue et le général jugé en cour martiale. Les fils du militaire, persuadés de l’innocence de leur père, entreprennent de laver son honneur.
Tout l’enjeu du film est de rassembler autour de notables douteux, deux frères fondamentalement différents qui ne se parlent plus depuis des années ; l’un est capitaine de cavalerie, l’autre un homme libre. Chacun a son idée de comment rétablir la vérité. Leurs ennemis communs, toujours aux aguets, ont fait fortune.
Le mythe de l’Ouest en prend un coup dans les gencives, mais pour le meilleur. L’histoire est rondement menée et l’interprétation de qualité. Victor Mature, souvent décrié pour son manque de charisme, ne manque pas d’autorité. Le manichéisme n’a pas sa place dans ce western qui souligne la complexité des rapports humains. Les clairs-obscurs d’un noir et blanc restauré subliment une incroyable chasse à l’homme au cœur de la ville. La dernière demi-heure, celle des règlements de comptes, gagne encore en intensité. Bonne pioche, comme dirait l’Etranger.
 Les Sept Chemins du couchant, de Harry Keller avec Audie Murphy, Barry Sullivan, Venetia Stevenson… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Les Sept Chemins du couchant, de Harry Keller avec Audie Murphy, Barry Sullivan, Venetia Stevenson… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Par bien des aspects, Les Sept Chemins du couchant ressemble à La Chevauchée du retour d’Allen H. Miner ; un homme de loi qui a tout à prouver à ses supérieurs doit ramener à la justice afin d’être jugé un vieux briscard qui a passé sa vie à défier les autorités.
Comme d’habitude, naît l’impossible mais réelle amitié entre deux hommes quand le chemin du retour est jonché de péripéties. La péripétie est une plante épineuse qui ne pousse qu’au Far West. Le jeune ranger apprend la vie aux cotés de l’expérimenté brigand. C’est dans l’adversité… Vous connaissez le refrain.
Les Sept Chemins du couchant ne donne pas dans la démesure. C’est un western simple, bien écrit et mis en scène, souvent drôle, et produit par un expert (Gordon Kay a de la bouteille et de l’expérience). Cerise sur le gâteau, un surprenant twist final.
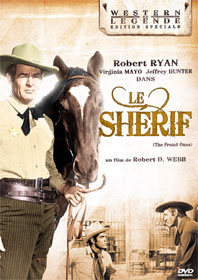 Le Shérif avec Robert Ryan, Virginia Mayo, Jeffrey Hunter… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Le Shérif avec Robert Ryan, Virginia Mayo, Jeffrey Hunter… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Le Shérif est un coup de cœur. Le format scope et l’image restaurée explosent les mirettes. Que c’est beau ! La qualité exceptionnelle de ce western tient dans la transversalité de son scénario qui brasse les thématiques à différentes échelles et à différents points de vue.
Nous sommes dans une localité de l’Ouest qui, grâce à l’arrivée du chemin de fer, connaît la prospérité. La ville s’étend avec son lot de nouveaux habitants, propriétaires et commerçants. Le Marshall du coin, Cass Silver, ne manque pas de boulot. Un tenancier de saloon, trafiquant notoire dont la réputation n’est plus à faire, commence son trafic. Afin de salir Silver et ainsi s’assurer une relative tranquillité, ce dernier lui reproche d’avoir eu, il y a quelques années, la gâchette facile, et pour cette faute d’avoir perdu son étoile. Cass Silver vit mal son passé resurgir. Pendant ce temps, Thad, un jeune homme fougueux, débarque en ville à la recherche du meurtrier de son père.
L’un des thèmes récurrents du western traite des rapports entre l’individu et le collectif où le sujet principal s’articule autour de l’image de marque du héros et de l’antihéros. Les petites gens de la communauté considèrent les leaders, leur leader, qu’ils soient du côté du bien ou du côté du mal. Le leader conquiert les terres et les esprits. La question de l’héroïsation du mal fera l’objet d’un prochain papier.
Si le scénario en impose (la raison, le pardon, la loi de cause à effet, le partage…), la réalisation n’est pas folichonne. Toutefois très recommandé.
 Le juge Thorne fait sa loi, de Jacques Tourneur, avec Joël McCrea, Miroslava, Kevin McCarthy… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Le juge Thorne fait sa loi, de Jacques Tourneur, avec Joël McCrea, Miroslava, Kevin McCarthy… (Sidonis Calysta/Seven 7)
L’Amérique vue sous le prisme d’un cinéaste européen a toujours de quoi susciter la curiosité et l’intérêt. Jacques Tourneur, exilé chez l’oncle Sam depuis le milieu des années 1930, ne fait pas honte à sa patrie d’origine, bien au contraire. Tourneur, technicien visionnaire (l’effet-bus, c’est lui) utilise le procédé Ansco Color qui donne à l’image cet aspect de vieille carte postale, une patine tout à fait vintage. L’éditeur s’excuse de l’image pourrie, quant à moi je la trouve magnifique. Le charmeur agit, c’est l’effet Tourneur.
Le juge Rick Thorne va de ville en ville rendre la justice. Son intégrité (et son courage) l’amène à régler des affaires délicates, et c’est la raison pour laquelle on le dépêche dans la petite localité de Bannerman où le fils d’un riche propriétaire est accusé de meurtre. Thorne se rend vite compte que toute la localité appartient à Josiah Bannerman, qui règne en despote. Mais la révolte gronde parmi les habitants.
Thorne n’est pas le justicier qui défouraille à la moindre bisbille, mais l’homme de loi qui privilégie le dialogue, convaincu de la puissance des mots et de l’intelligence des hommes. Bannerman, la ville, s’est mise hors système, totalement repliée sur elle-même. Thorne trouve face à lui des durs à cuire qui apprécient assez peu de voir leurs privilèges supprimés, mais aussi les regards nouveaux d’hommes et femmes soulagés.
Le juge Thorne fait sa loi a tout du drame shakespearien. La mise en scène de Jacques Tourneur, élaborée et inspirée (certaines scènes devraient être étudiées en école de cinéma ; l’ouverture est fantastique), bétonne un scénario certifiée « haute qualité cinématographique ». Du tout bon.
 La Reine des rebelles, d’Irving Cummings avec Gene Tierney, Randolph Scott, Dana Andrews… (Sidonis Calysta/Seven 7)
La Reine des rebelles, d’Irving Cummings avec Gene Tierney, Randolph Scott, Dana Andrews… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Selon la Columbia, La Reine des rebelles devait être un nouvel Autant en emporte le vent. C’est pas vraiment ça ! Le film ne manque pas d’atouts mais nous sommes loin du chef-d’œuvre. En période post-Sécession, la jeune Belle épouse Sam Starr, un ancien rebelle sudiste. Belle n’adhère pas aux méthodes revanchardes de son mari mais quand celui-ci est fait prisonnier par les autorités du nouveau gouvernement, Belle devient «Belle, la reine des rebelles ». Belle, c’est un mot qu’on dirait inventé pour elle – chanson tirée d’une comédie musicale qui abîme les yeux et les oreilles.
Après la guerre de Sécession, le sud de l’Amérique a été ratissé de fond en comble pour débusquer la racaille sudiste. Les exactions de l’armée régulière et des irréguliers nordistes n’ont pas aidé à une rapide réconciliation entre les communautés, le sud devenant la poubelle de l’Amérique pour les siècles à venir.
Le film progresse en de courts flash-back où les domestiques noirs en mode Banania (Ouh lala, y’a bon la maîtwesse… bof quoi !) se rappellent la cruelle (et vraie) histoire de Belle Starr.
Même si Gene Tierney est d’une beauté à couper le souffle, La Reine des rebelles, tourné en 1941, a pris un sacré coup de vieux.
 Quantez, leur dernier repaire, de Harry Keller avec Fred MacMurray, Dorothy Malone, James Barton… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Quantez, leur dernier repaire, de Harry Keller avec Fred MacMurray, Dorothy Malone, James Barton… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Harry Keller aux manettes, Gordon Kay à la production, vous pouvez être tranquille quant à la qualité du produit (voir Les Sept Chemins du couchant). Robert Wright Campbell, qui goupille le scénario, adaptera sept ans plus tard pour Roger Corman une nouvelle d’Edgar Allan Poe, Le Masque de la mort rouge. Quantez naît sous les meilleurs hospices.
Après une série d’attaques de banque, cinq malfrats décident de se mettre au vert près de la frontière mexicaine et font halte à Quantez. Sur place, plus âme qui vive ! Livrés à eux-mêmes, les esprits s’échauffent. La solidarité des grands coups laisse la place aux rivalités et règlements de comptes. Les Indiens se rapprochent de Quantez.
Quantez, série B par excellence, ne bouleverse pas le genre, il est le meilleur des prétextes pour jeter dans l’arène cinq olibrius qui ne pensent qu’à se mettre sur la tronche et, accessoirement, voler la part de l’autre. Le traître, le bandit sur le chemin de la repentance, le jeune écervelé, le trouillard composent la fine équipe. Mais la bonne idée, c’est le chef autoritaire tout à fait incapable de diriger ses hommes tant il est instable. Sans oublier la blonde incendiaire qui met l’huile sur le feu, allant de mâle en mâle dans le dessein d’assurer ses arrières. La cochonne.
Quantez est aussi divertissant que brut de décoffrage. Les scènes d’actions viriles et cruelles ne manquent pas.
 Quand meurent les légendes, de Stuart Millar avec Richard Widmark, Frederic Forrest, Luana Anders… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Quand meurent les légendes, de Stuart Millar avec Richard Widmark, Frederic Forrest, Luana Anders… (Sidonis Calysta/Seven 7)
Voilà le western nostalgique par excellence. Quand meurent les légendes met un point final aux espoirs d’entente entre Blancs et Indiens. Le constat est sans appel : la société moderne a échoué à réconcilier ses peuples ou, peut-être, ne l’a-t-elle jamais vraiment souhaité.
Red Dillon, dresseur de chevaux, recueille jusqu’à sa majorité Thomas Black Bull de la tribu des Ute. Dillon entraîne Thomas aux rudiments du rodéo ; l’Indien déraciné, capable depuis sa tendre enfance de mater les canassons les plus coriaces, montre des capacités hors du commun. Tous deux partent sur les routes et enchaînent les concours, les succès et les désillusions. Un peu comme Miss France, mais en plus couillu.
Tout est dans le titre. Le cow-boy à l’ancienne n’est plus et l’Indien moderne condamné à retourner dans sa réserve.
Dingue comme ce western des années 1970 nous fait comprendre qu’une page se tourne. Plus rien n’est à conquérir en Amérique, à part les amateurs de tradition.
En pleine guerre du Vietnam (le film date de 1972), Stuart Millar (producteur du Prisonnier d’Alcatraz, Que le meilleur l’emporte, Little Big Man et réalisateur d’Une bible et un fusil, le vrai True Grit, Rooster Cogburn) négocie le virage délicat du cinéma social et militant. Frederic Forrest, qui deviendra l’un des acteurs fétiches de Francis Coppola (Conversation secrète, Apocalypse Now, Tucker) et Wenders (Hammett), tient la dragée haute à Richard Widmark. Une œuvre désenchantée et inédite.
